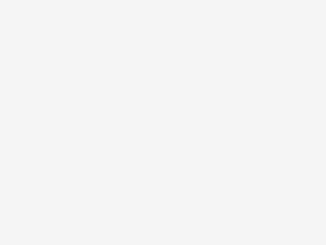Paru le 24 juin 2025 dans la revue Kairos
Dans leur Manifeste pour la paix, qui avait déjà recueilli 936 000 signatures en Allemagne, la politicienne Sahra Wagenknecht, alors encore membre du parti de gauche Die Linke, et la journaliste féministe Alice Schwarzer écrivent, le 2 janvier 2023, au sujet de la guerre en Ukraine : « Plus de 200.000 soldats et 50.000 civils ont été tués jusqu’à présent. Des femmes ont été violées, des enfants ont été effrayés, un peuple entier a été traumatisé. »
Le 17 septembre 2024, un an et huit mois plus tard, le Wall Street Journal estime le nombre de blessés et de morts à un million (Pancevski, 2024). Depuis le début de l’invasion jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis ont, selon le rapport du département d’État, fourni 66,5 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Cela comprend des armes avancées, une formation et un soutien logistique (United States Department of State, 2025). Le 14 septembre 2024, l’Institut d’économie mondiale de Kiel (capitale de l’État fédéré de Schleswig-Holstein) a rapporté qu’environ 267 milliards € d’aide ont été mis à la disposition de l’Ukraine depuis le début de la guerre. Cela correspond à 80 milliards € par an : « Sur ce total, environ 130 milliards € (49%) ont été consacrés à l’aide militaire, 118 milliards € (44%) à l’aide financière et 19 milliards € (7%) à l’aide humanitaire » (IfW Kiel, 2025). Dans ce contexte, l’Europe a déjà dépassé l’aide des États-Unis.
Si l’on en croit l’Atlantic Council, un groupe de réflexion de Washington proche de l’OTAN, la Russie a réussi à conserver l’initiative militaire sur le champ de bataille tout au long de l’année 2024 et à progresser en termes de gains territoriaux sur plusieurs sections de la ligne de front longue d’approximativement 1.000 kilomètres (Bielieskov, 2025). L’année dernière, l’Ukraine a également connu un nombre sans précédent de désertions, ce qui a encore affaibli la capacité de défense du pays, déjà fragilisée. Si l’on ne parvient pas à contrecarrer cette évolution, l’Ukraine risque de subir de graves conséquences, selon l’auteur de l’Atlantic Council.
Il ne serait sans doute pas incompréhensible, dans une telle situation, avec de tels chiffres de morts et de blessés, d’argent dépensé en armes et en aide humanitaire, avec l’affaiblissement de l’Ukraine par l’émigration — près de 7 millions de personnes, soit environ 18% de la population, selon les estimations du HCR, ont quitté l’Ukraine depuis le début de la guerre — et la désertion, de remettre en question l’efficacité de 1.000 ou 100.000 morts supplémentaires et de milliards d’euros d’aides. Après trois ans de réarmement massif, qu’est-ce qui pourrait être résolu par un réarmement et des livraisons d’armes supplémentaires par rapport au gain de territoire russe ?
À cela s’ajoute — un argument que les défenseurs de la paix par les armes aiment mettre en avant de manière abstraite et sans aucune donnée chiffrée — le fait que, selon les dernières estimations de la Gallup Organization de Washington, la moitié des citoyens ukrainiens souhaitent une « fin rapide et négociée de la guerre » (Gallup, 2025). Il semble que les défenseurs de la guerre se soucient aussi peu de l’opinion réelle des Ukrainiens que les acteurs actuels de l’apparente « paix imposée » (Diktatfrieden, Olaf Scholz, le 17 février 2025 à Paris). De tels chiffres peuvent bien entendu être remis en question, d’autant plus qu’il s’agit à chaque fois des meilleures estimations disponibles à l’heure actuelle, mais dont la précision doit être relativisée par des données limitées, des évolutions dynamiques et des incertitudes liées à l’enquête.
On pourrait aussi, comme Marie-Agnes Strack-Zimmermann, députée du parti libéral allemand, présidente de la commission de la sécurité et de la défense du Parlement européen, présenter les chiffres purement imaginaires reflétant une idéologie belliciste détachée de toute réalité. Mme Strack-Zimmermann a récemment affirmé, lors d’un débat, que Poutine avait « mis des centaines de millions sous terre » et que l’Ukraine « nourrissait 70 milliards de personnes » (sic, ORF « Im Gespräch », 25 mars 2025). Nous retrouvons ici une habitude prise lors de la pandémie, où la politique et les médias normalisaient à grande échelle de telles techniques de chiffres imaginaires politisés, favorisant une instrumentalisation stratégique des déclarations quantitatives.
On avouera que le débat se simplifie considérablement lorsque l’on se détache complètement de la réalité pour argumenter à partir de seules convictions et croyances. Il devient alors possible, dans une attitude vertueuse, de se mettre en scène en tant comme partisan de la démocratie et de masquer de manière moralisatrice l›« intolérance contre les dissidents dans la dénonciation et l’exclusion publiques ». De plus, il en résulte dans le journalisme éducatif actuel « la tendance à transformer des questions politiques complexes en certitudes morales » (Die Zeit, 2020).
C’est précisément cette démonstration d’un illibéralisme travesti en vertu démocratique que publie le Luxemburger Wort dans son édition du 27 mars 2025. En accord idéologique avec le député David Wagner de Déi Lénk (La gauche), Diego Velazquez, rédacteur du Wort avec « un bagage académique interdisciplinaire en philosophie, linguistique, communication et théorie des sciences », s’exprime ainsi sur la question ukrainienne :
« En affrontant la réalité de la guerre sur le continent — au lieu de croupir en marge avec l’ADR — les Déi Lénk ont à nouveau le droit de faire entendre leur voix dans le débat actuel sur la défense. » (Velazquez. Mot. 27 mars 2025).
Ce que l’on présente comme une « réalité » correspond en réalité aux convictions politiques et morales du journaliste de droite ; des convictions que partage, de manière révélatrice, une large part de la « jeune gauche ». Le lecteur comprend que seul celui qui s’adapte à la « réalité » du consensus d’opinion, apparemment indiscutable, a le droit de s’exprimer. La question de savoir si ce consensus d’opinion repose sur un quelconque rapport à la réalité est déjà superflue dans un tel discours.
Celui qui n’est pas fidèle à la ligne devrait être exclu du discours démocratique. Et cela signifie, dans le vocabulaire des illibéraux : l’opposition brûle à l’écart. C’est la même logique d’exclusion que celle pratiquée par la gauche dite « de style de vie » à l’égard de la droite. Celui qui pense différemment est anti-démocratique. La démocratie, qui dans les rêves de certains philosophes politiques devait un jour signifier le pluralisme participatif, est ici reléguée derrière les murs coupe-feu de la pression de conformité tacite et condamnée au silence politique. Ce nouvel ordre « démocratique » est représenté, selon le mot, aussi bien par la « jeune gauche » que par la droite antilibérale. Dans ces faux débats, la volonté de se ranger et l’orientation vers la position majoritaire homogénéisée pèsent plus lourd que la critique substantielle de gauche.
Depuis mars 2020, la « jeune gauche », par son soutien unanime à un état d’urgence douteux, qu’elle avait encore rejeté fermement trois ans plus tôt, avec force morale et juridique, a érigé son allégeance groupusculaire, dans un contexte marqué par l’autoritarisme, en fondement idéologique de son identité politique. Il s’agissait ainsi de garantir durablement la capacité d’adaptation de Déi Lénk comme partenaire de coalition potentiel et de durcir la ligne morale porteuse au sein du parti contre les « vieux gauchistes » guidés par des principes.
En fait, cette « jeune gauche » agit surtout en realpolitik politicienne lorsqu’elle adopte l’opinion dominante, avec une touche de rhétorique gauchiste personnelle. Car les calculs tactiques des partis et les mises en scène stratégiques remplacent de plus en plus la substance politique et révèlent ainsi la véritable réalité d’une démocratie de spectacle. Le fait que des faits politiques soient déjà imposés quelques semaines avant le débat interne du congrès du parti, grâce au soutien du journal de la droite conservatrice, révèle la stratégie du pouvoir derrière la conception fondamentalement illibérale d’une jeune oligarchie de parti (au sens de Robert Michels) bien-pensante. La « jeune gauche » adopte ainsi ce que l’une des têtes pensantes de la gauche « obsolète » (Velasquez & Wagner, 2025) — Chantal Mouffe — appelait la position post-politique : « Ce que j’appelle post-politique, c’est le fait que les citoyens ne peuvent plus choisir entre différentes conceptions ». « La démocratie, poursuit Mouffe, doit être agonistique, il doit y confrontation et donc possibilité de choix. Nous avons un consensus du centre et c’est mauvais pour la démocratie » (Martini & Mouffe, 2018). Dans ce populisme du centre radical, la « jeune gauche » s’insère volontiers dans un alignement flexible avec la droite conservatrice.
Après que Marx eut résolument replacé l’histoire mondiale hégélienne sur les pieds de l’économie réelle, voilà que de jeunes politiciens, de gauche comme de droite, épaulés par la cavalerie médiatique, parviennent de nouveau à incliner cette tête assez bas pour qu’elle s’endorme paisiblement dans les canons des rapports de force en vigueur. Le principe de cette Realpolitik est alors une fois de plus : Tant pis pour les faits ! Mais la morale est sauve. Et, quelque part, au milieu des ruines, elle poursuit sa marche, la vérité des justes, droite, intacte, avec la dignité de celui qui n’a rien vu. Les morts paient, les mutilés traînent leur douleur, les violées expient.
Bibliographie :
- Martini, T., & Mouffe, C. (2018, 10 octobre). Chantal Mouffe sur la démocratie : “Le populisme peut être progressiste”. Le quotidien : taz. https://taz.de/Chantal-Mouffe-ueber-Demokratie/!5538435/
- Le temps. (8 juillet 2020). “Libéralisme : la résistance ne doit pas devenir un dogme”. https://www.zeit.de/2020/29/cancel-culture-liberalismus-rassismus-soziale-gerechtigkeit
- Pancevski, B. (2024, 17 septembre). “Toll of Dead and Injured Hovers Near One Million in Ukraine War”. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/world/one-million-are-now-dead-or-injured-in-the-russia-ukraine-war-b09d04e5
- Gallup Inc, G. (2024, 19 novembre). La moitié des Ukrainiens souhaitent une fin rapide et négociée à la guerre. Gallup.Com. https://news.
- Bielieskov Mykola. (2025, 7 janvier). “Poutine commence 2025 confiant de sa victoire alors que la guerre d’attrition prend de l’ampleur en Ukraine”. Conseil de l’Atlantique. https://www.
- Coopération américaine en matière de sécurité avec l’Ukraine. (12 mars 2025.) United States Department of State. https://www.
- Riegel, Tobias. (28 mars 2025) “Strack-Zimmermann tourne la page : “Poutine a enterré des centaines de millions de personnes”. NachDenkSeiten – Le site web critique. Consulté le 30 mars 2025, par https://www.nachdenkseiten.de/?p=130845
- IfW de Kiel. (14 septembre 2025). Soutien à l’Ukraine après 3 ans de guerre : les flux d’aide restent faibles mais stables – changement d’orientation vers l’achat d’armes. https://www.
- Velasquez D. & Wagner, D. (2025, 27 mars). “David Wagner sort Déi Lénk de la marginalité politique”. [Luxemburger Wort]. https://www.wort.lu/politik/david-wagner-holt-dei-lenk-aus-dem-politischen-abseits/51683721.html
- Javel, F. (2025, 30 mars). “David Wagner s’aliène l’ancienne gauche avec sa volte-face sur l’Ukraine”. Luxemburger Wort. https://www.wort.lu/politik/david-wagner-entfremdet-alt-linke-mit-ukraine-kehrtwende/51704131.html