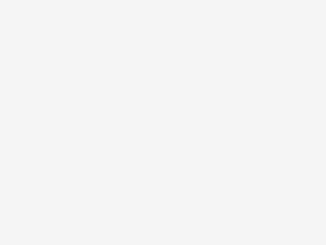Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors ? Tout ce qu’ont fait les hommes, les hommes peuvent le détruire… (J.-J. Rousseau. Émile ou De l’éducation. 1762)
La notion moderne de crise implique une « contrainte de décision » où se détermine le sort d’un temps historique, d’une configuration politique, d’une situation économique, voire du monde sans son ensemble.
Il aura fallu attendre le XVIIIᵉ siècle pour que le concept de « crise » issu de la médecine hippocratique vienne à s’appliquer aux phénomènes de la politique. Dans son sens politique, constate l’historien R. Koselleck, la crise prit d’abord une signification assez large. Vers la fin du XVIIᵉ et au début du XVIIIᵉ, la crise politique caractérisait dans l’ensemble des situations politiques et militaires s’aggravant, au point d’entraîner une situation de préservation ou de dissolution de l’ordre politique. Dans ce sens la « crise » politique se conçut par analogique avec la crise hippocratique (médicale) du diagnostic – comme moment de manifestation d’une décision radicale – et du jugement – la résolution de la situation pour le meilleur ou le pire.
À partir de la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle, la notion de crise se rattache également à la signification religieuse du Judicium (jugement dernier) : c’est au moment de la crise que se décide définitivement et irréversiblement le sort d’une culture ou d’une civilisation.
C’est dans ce sens que Friedrich Schiller écrit, dans l’un de ses poèmes : « l’histoire du monde est le jugement du monde » (« Die Weltgeschichte ist das Weltgericht », Resignation 1784).
Chez Schiller, l’histoire du monde devient elle-même une crise permanente. Dans le poème « Résignation » de 1784, un « moi » défunt se plaint de la promesse non-tenue du jugement dernier. Ayant sacrifié le bonheur terrestre pour la promesse d’un bonheur éternel d’après la mort, le défunt se rend compte que par-delà le fleuve qui le sépare de la vie, rien ne l’attend. Le bonheur espéré dans l’au-delà – « la terreur […] réservée aux méchants et la joie aux justes » – n’existe pas. La promesse théologique n’était qu’une illusion menteuse. Ainsi, réclamant sa récompense de juste, le défunt entend répondre un « esprit » :
Wer dieser Blumen Eine brach, begehre
Die andre Schwester nicht.
Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre
Ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre.
Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.1
Le temps passé au renoncement était donc un temps perdu : « ce que l’on retranche d’une minute, l’éternité ne le rend jamais ». Il n’y a pas de jugement dernier, il n’y a pas de récompense dans l’au-delà, c’est l’histoire d’un monde sécularisé qui ici devient le lieu et le temps du Jugement dernier.
Avec Schiller, la signification religieuse de la crise prend donc en même temps un sens post-théologique. La crise comme temps sécularisé doit imposer la décision entre les deux fleurs, les deux modes de vie : l’espoir du Jugement dernier dans l’au-delà (Hoffnung) ou la jouissance (Genuß) de la vie terrestre. Mais une fois sécularisée, la crise devient décision permanente d’une histoire sans au-delà et dépourvue de toute justice supérieure rémunératrice. Schiller énonce donc l’une des conceptions modernes courantes du concept de « crise » : l’histoire est une crise permanente où l’avenir se décide à tout moment. Cette histoire n’est donc implicitement plus celle du temps linéaire de l’eschatologie – ou de sa version modernisée comme progrès et croissance – mais un temps interrompu par des coupures imprévues.
C’est chez Rousseau (Émile ou de l’éducation, 1762) toutefois que l’on trouve le premier usage proprement moderne de la crise. Rousseau conçoit la crise en opposition à l’idée du progrès historique – la conception eschatologique de l’histoire conçue comme progression linéaire vers un ‘monde meilleur’ – et celle de la stabilité du temps cyclique de l’histoire – la conception naturalisante de l’histoire. La crise est ce qui vient rompre le mouvement linéaire de l’histoire ou l’ordre cyclique du temps pour y instaurer la possibilité du radicalement nouveau.
De ce fait, la crise implique en même temps une conception nouvelle de la révolution. Originairement conçue sur le modèle cyclique du temps et de l’histoire – à l’instar du mouvement orbital des corps célestes – la révolution conçue comme crise ouvre à un avenir imprévisible, et à une fin incertaine et inattendue de l’état présent.
À la suite de Rousseau, en 1778, Denis Diderot décrit une crise – dans le contexte de l’époque des agitations prérévolutionnaires à Paris – où, suivant la formulation de R. Koselleck, le peuple parisien était prêt à croire à tout ce qui promettait une résolution des conflits, à une période où des amitiés se brisaient et des associations improbables d’opposants (Koselleck, 1991). Dans une formulation d’une étonnante actualité, Diderot écrit :
C’est l’effet d’un malaise semblable à celui qui précède la crise dans la maladie : il s’élève un mouvement de fermentation secrète au dedans de la cité ; la terreur réalise ce qu’elle craint.2
Avec Rousseau et Diderot se situe donc aux origines de la notion moderne de la crise.
Les significations historiques de la notion de « crise »
Historiquement, le concept moderne de crise se développe suivant quatre sens différents : celui de la crise comme précipitation d’un moment de dénouement, celui de la crise comme état permanent, celui de la crise comme événement unique, mais réitéré et celui de la crise comme moment d’un dernier jugement, d’une éventuelle fin de l’histoire.3
- La conception ‘médicale’ de la crise politique représente le sens le plus courant que nous accordons aujourd’hui encore à la crise. Dans cette perspective, la crise politique ou économique représente le moment où tout concourt à une situation de non-retour d’un avenir qui se heurte à une décision aux conséquences imprévisibles. Changement radical et historique de l’ordre politique donc, qui ne permet pas de prévoir ce qu’il en sera par-delà la crise. De ce point de vue, et avec la distance historique qui est la nôtre, nous pourrions relire différemment l’idée d’une « crise » financière qui a secoué le monde en 2007/2008. D’une part, cette « crise » était prévisible sous bien des d’égards, et d’autre part, elle n’a pas apporté les grands changements – le nouveau monde post-capitaliste – espérés. (La notion de crise économique mériterait néanmoins quelques développements supplémentaires, voir pt. 4 ci-dessous.) Bien au contraire. La question de savoir si la pandémie du Covid représente une crise dans ce sens, c’est-à-dire un moment de rupture politique, économique et social profond, reste à voir.
- Suivant une deuxième interprétation de la notion de crise, l’histoire moderne peut être interprétée comme crise permanente. La crise est dès lors conçue comme processus par lequel l’histoire du monde devient, suivant l’expression de Schiller, sécularisation du « Weltgericht ». Dans une version plus récente, la conception darwinienne, avec sa survie du plus apte, pourrait se concevoir comme modèle naturalisé d’une crise permanente, où la survie des espèces elle-même est soumise à la pression constante d’une décision de survie ou d’extinction. Ici, ce sera une nature soumise à l’arbitraire des changements environnementaux et de la sélection conséquente qui se poserait en juge de l’histoire. Une variante que l’on retrouve dans nombre d’arguments écologiques contemporains du rôle de l’activité humaine sur l’écosystème terrestre. Si l’histoire est conçue comme crise permanente, si le temps de l’histoire constitue en même temps un jugement de ce qui précède – persévérance, durabilité, continuité et croissance vs. disparition, suppression, effondrement et décadence – chaque moment historique représente donc une « contrainte de décision » où se décide le sort du présent et de l’avenir.
- La crise peut être interprétée comme événement plus ou moins unique et singulier où une situation précédemment stable se précipite, par une accélération soudaine, en un changement de la situation. De telles crises peuvent, bien évidemment se répéter et se succéder, mais elles n’en restent pas moins des moments exceptionnels qui viennent à interrompre le cours linéaire de l’histoire. La notion de crise économique relève de cette interprétation itérative et disruptive de la crise. Comme le montre R. Koselleck dans son analyse de l’histoire de la notion de « crise », la « crise économique », qui repose sur la conception de l’équilibre du XVIIIᵉ siècle, s’inscrit dans la logique temporelle de cette conception. Dans la crise économique, l’équilibre supposé entre offre et demande, entre circulation d’argent et circulation de marchandises, entre production et consommation. La crise représente donc un moment récurrent (même cyclique) du dérangement de l’équilibre. Raison pour laquelle les crises économiques ont pu être interprétées dès le XIXᵉ siècle comme génératrices historiques du progrès.
- La crise peut également représenter le moment ultime, l’instant du « dernier jugement » où l’histoire en vient à sa fin. Ce topos théologique, plus particulièrement de la conception eschatologique de l’histoire – le temps historique conçu comme évoluant vers une fin du monde, le second avènement du Christ – semble aujourd’hui retrouver une nouvelle actualité. On pensera en premier lieu aux travaux de Günther Anders sur la bombe atomique (Anders, 1995). Dans la même ligne de pensée, Koselleck écrit en conclusion de son analyse du concept de la crise : « La question se pose donc de savoir si notre modèle sémantique de la crise comme décision finale n’a pas obtenu plus de chances de se réaliser que jamais auparavant. Si tel est le cas, tout dépendrait de l’orientation de toutes les forces vers la prévention de la chute. » (Koselleck, op. cit.)
Si l’on suit cette ligne de pensée la notion de « crise » et son usage explicite dans les discours politiques, économiques, sociologiques et journalistiques ne serait pas seulement la marque de la modernité, mais l’histoire même de la modernité serait une histoire des crises et des révolutions. Ce constat est dressé pour la première fois dans les passages bien connus du « Manifeste du Parti Communiste » de Marx et de Engels en 1847, où la bourgeoisie est décrite comme une classe essentiellement révolutionnaire :
La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire. […] La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l’ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes.
Loin donc de représenter une atteinte ou une perturbation extraordinaire, la crise représente donc un moment constitutif de l’histoire moderne. L’histoire moderne, pourrait-on dire, est celle du temps de la crise. C’est ce que souligne par ailleurs l’extraordinaire essor de la notion de crise autant dans les discours que dans les pratiques politiques, sociales et économiques.
C’est ce que conclut le philosophe Paul Ricoeur dans son analyse du concept de « crise » :
Dès lors, ce qui paraît le mieux caractériser la crise de notre époque, c’est, d’une part, l’absence de consensus dans une société divisée, comme on l’a dit, entre tradition, modernité et postmodernité ; c’est ensuite, et plus gravement, le recul général des convictions et de la capacité d’engagement que ce recul entraîne ou, ce qui revient au même, le recul général du sacré, qu’on l’entende comme sacré vertical (religieux au sens le plus large) ou sacré horizontal (politique au sens le plus large).
Dans l’histoire moderne, la crise est devenue un « fait social total » (Mauss, 1923/24), c’est-à-dire un évènement global qui atteint tous les niveaux d’une société et qui ne peut être abordé qu’à travers « les représentations que la société se fait d’elle-même ».
Pour cette raison, les moments de crise marquent des moments d’organisation, de désorganisation ou de réorganisation sociales bien caractérisés et repérables. C’est l’analyse que propose la sociologie de la crise.
À suivre : la sociologie de la crise
Bibliographie
- Anders, G. (1995). Hiroshima ist überall (Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe). Verlag C.H. Beck.
- Koselleck, R. (2016). Begriffsgeschichten : Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache (3. Aufl. 2016). Suhrkamp.
- Koselleck, R. (1995). Krise. In O. Brunner, W. Conze, & R. Koselleck (Éds.), Geschichtliche Grundbegriffe : Vol. Bd.3 H‑Me (Unveränd. Nachdr., 1. Aufl, p. 617‑650). Klett Cotta.
- Fukuyama, F. (2006). The End of History and the Last Man (Reissue Edition). Free Press.
- Mauss, M. (1923 – 1924). Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques. L’année sociologique, nouvelle série, tome 1.
- Ricœur, P. (1988). La crise : Un phénomène spécifiquement moderne ? Revue de Théologie et de Philosophie, 120(1), 1 – 19.
- Schiller, F. (1992). Werke und Briefe, Bd. 1. Deutscher Klassiker Verlag.
Notes
- « Que celui qui a cueilli une de ces fleurs n’espère pas avoir l’autre. Que celui qui ne peut pas croire cherche la jouissance. Cette loi est éternelle comme le monde. Que celui qui peut croire sache attendre. L’histoire du monde est le jugement du monde. » (trad. Xavier Marmier, 1854) ↩︎
- Diderot, D. (1778), Essai sur les règnes de Claude et de Néro, cité dans Koselleck, 1995. ↩︎
- La version sécularisée moderne de la « fin de l’histoire » a été introduite par la Phénoménologie de l’esprit(1807) de G.W.F Hegel. La variante la plus récente d’une fin de l’histoire se trouve bien évidemment dans l’ouvre bien connu de Francis Fukuyama – The End of History and the Last Man (1992) – qui diagnostique la fin de la guerre froide comme instauration définitive de la démocratie libérale et de l’économie de marché comme modèle politique universel. ↩︎